Question à Mathieu GROSSETETE,
sociologue au CURAPP (Centre Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le Politique)
La loi de la représentation de la société française dans les médias représente-t’elle toute les populations ?
6 % de la population vit avec une limitation physique, mais l’ARCOM ne compte qu’une représentation de seulement 1 % privilégiant la représentation de handicap invisible.

Question à Mathieu GROSSETETE,
sociologue au CURAPP (Centre Universitaire de Recherches sur l'Action Publique et le Politique)

Le baromètre annuel révèle une surreprésentation du handicap dans les fictions télévisuelles, atteignant 71% de la présence totale. En comparaison, les programmes d’information représentent 12%, en baisse de 11 points par rapport à 2021, suivis par les divertissements (5%) et le sport (2%). NRJ12 se distingue avec une part de 5% grâce à une fiction quotidienne, tandis que TF1 fait un effort supplémentaire par rapport à d’autres chaînes généralistes historiques en affichant 1% de personnes en situation de handicap sur ses antennes.
Cependant, malgré cette présence accrue, la représentation du handicap reste stéréotypée. La personne handicapée est généralement dépeinte comme un homme blanc et inactif, souvent dans des rôles principaux à connotation négative.
Les recommandations de l’Arcom incitent vivement les éditeurs à intensifier leurs efforts en vue de promouvoir la participation des individus en situation de handicap dans les programmes d’informations.

Défenseur de la loi, L’ARCOM en France a pour mission de réguler les médias audiovisuels et numériques.
La charte de l’ARCOM énonce les principes et les valeurs qui guident son action. Elle met l’accent sur l’indépendance de l’autorité vis-à-vis du pouvoir politique et économique, ainsi que sur la transparence de ses décisions.
La charte de l’ARCOM insiste également sur le respect de la liberté d’expression et de la diversité des médias, tout en assurant la protection des publics.
Une formation difficile

Interview de Christine NANCY,
assistante de production et comédienne de doublage,
ancienne élève d'une école de journalisme

La population d’étudiants en situation de handicap représente moins de 3 % en 2020. Ce chiffre alarmant témoigne de l’exclusion persistante des personnes handicapées dans le monde des études, en particulier dans le domaine exigeant et compétitif du journalisme.
Plusieurs facteurs expliquent cette sous-représentation :
1. Discrimination et préjugés :
Les personnes handicapées sont souvent confrontées à des préjugés et à des discriminations lorsqu’elles postulent pour des écoles de journalisme. Des perceptions erronées de leurs capacités peuvent décourager ces candidats talentueux.
2. Accessibilité physique :
Les infrastructures des écoles de journalisme ne sont pas toujours adaptées aux besoins des personnes handicapées, rendant l’accès difficile voire impossible pour certains étudiants en fauteuil roulant ou ayant d’autres besoins spécifiques.
3. Besoins éducatifs spécifiques
4. Stages et opportunités professionnelles :
Les stages sont cruciaux pour acquérir de l’expérience en journalisme, mais les personnes handicapées peuvent rencontrer des difficultés à trouver des opportunités de stage adaptées à leurs besoins.
5. Barrières financières : Les frais de scolarité élevés des écoles de journalisme peuvent constituer un obstacle financier majeur pour de nombreux étudiants handicapés, d’autant plus que les aides financières disponibles ne sont pas toujours suffisantes.
Témoignages

Romane IDRES
Journaliste régionale,
Lauréate du prix du Bondy Blog 2020 contre les discriminations et pour l’égalité des chances),
Lors de cette conversation stimulante entre Nicolas Karasiewicz (vice-président de l'APHPP) et Romane, nous avons discuté des avancées législatives, des politiques inclusives, et des moyens de garantir l’égalité des chances pour tous, indépendamment de leur handicap.

Pascal TRIBO,
journaliste reporter,
formateur et consultant en vidéo
20 ans d'expérience à la télévision
Le point de vue des associations

Matthieu ANNEREAU, Conférencier aveugle et président de l'APHPP (Association pour la Prise en compte du Handicap dans les Politiques Publiques et Privées, et membre du Conseil Métropolitain de Nantes
Sa vision : il est grand temps que les chaînes de télé fassent évoluer leur perception des personnes handicapées en se détachant du prisme du handicap.
Aussi, il est nécessaire de permettre des interventions régulières sur des sujets qui concernent l’ensemble de la société tels que la culture, la sécurité et l’environnement.
Sophie CLUZEL a appelé les médias et l’industrie de la télévision à prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation. Cela inclut la création de personnages handicapés authentiques et diversifiés, l’embauche de professionnels handicapés dans tous les aspects de la production médiatique, et la promotion d’une culture d’inclusion.
Les initiatives prétendument en place pour soutenir les personnes en situation de handicap ressemblent de plus en plus à des actions fantoches, à des façades bien polies qui masquent une réalité beaucoup plus sombre. Les statistiques persistent à montrer des taux de chômage élevés parmi les personnes handicapées, un accès limité à l’éducation et à la formation, ainsi qu’une exclusion sociale persistante. Les promesses de changement et d’inclusion restent vaines pour de nombreuses personnes en situation de handicap



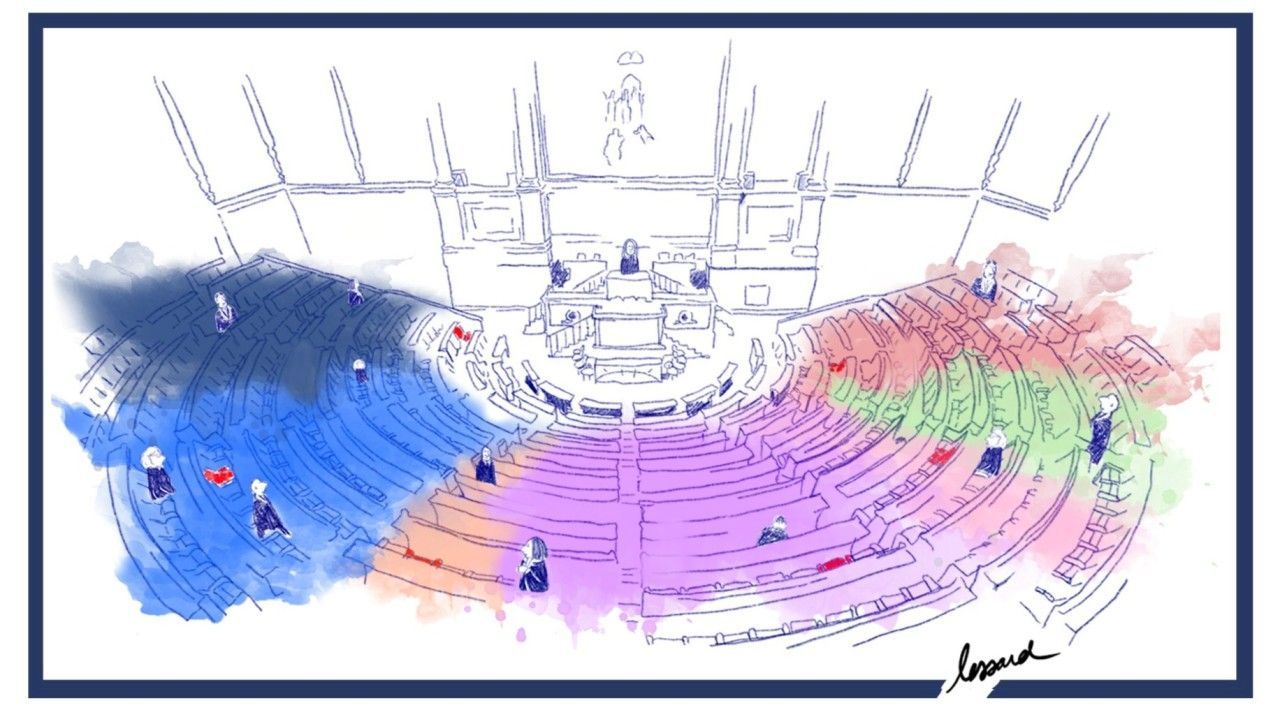






Cette association a pour but de redonner aux personnes handicapées, une parole volée trop souvent relatée avec un regard validiste. Promouvoir la place des personnes en situation de handicap sans discrimination.

Tous droits réservés | HandiNews - Mentions légales